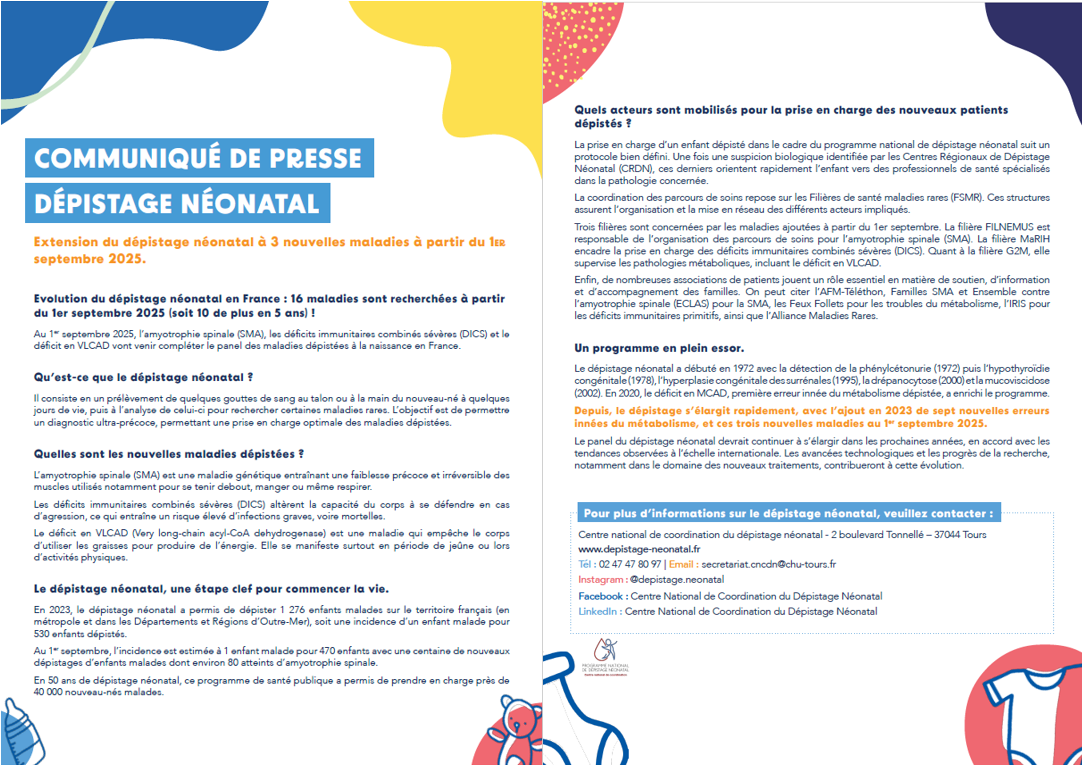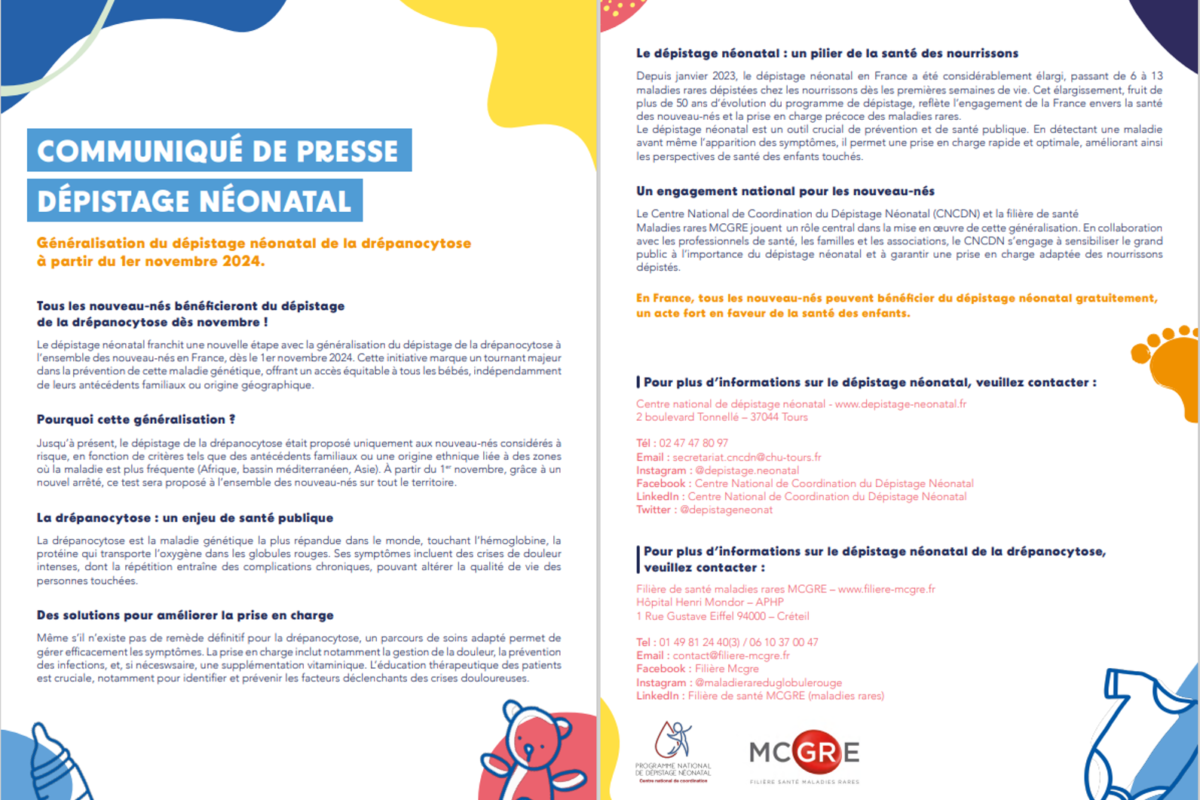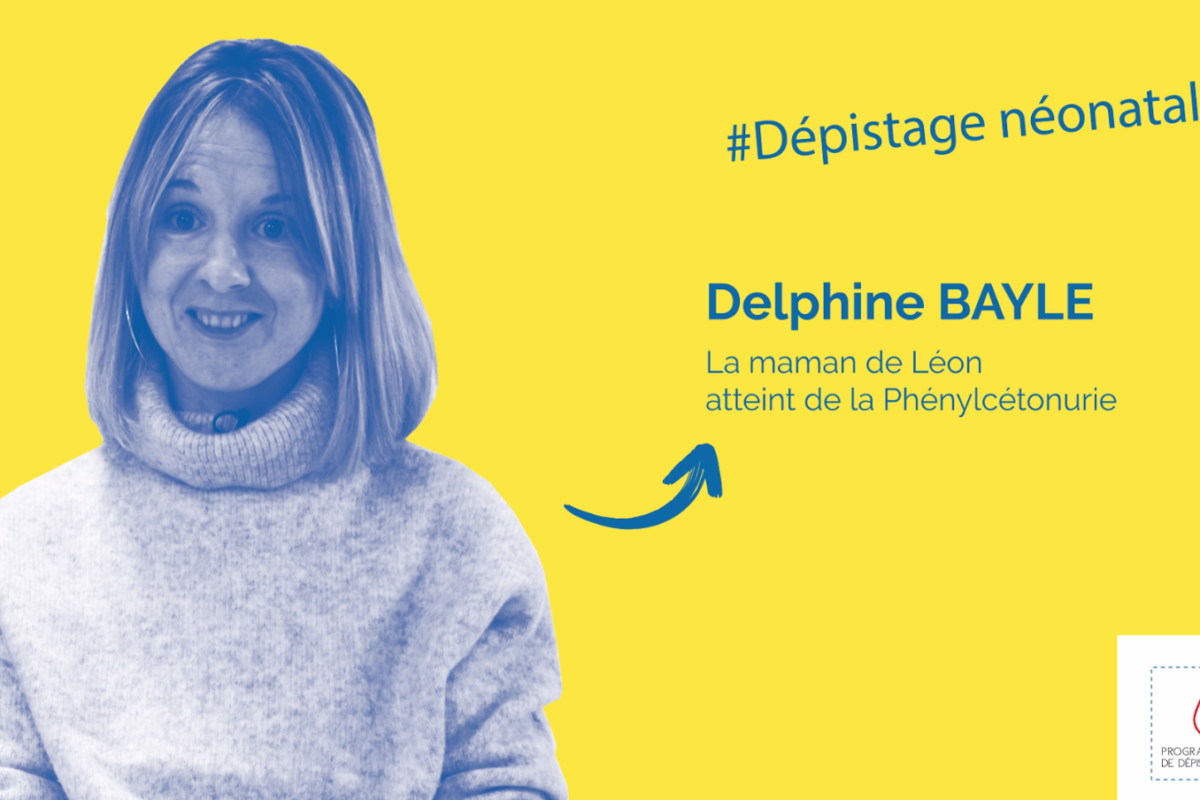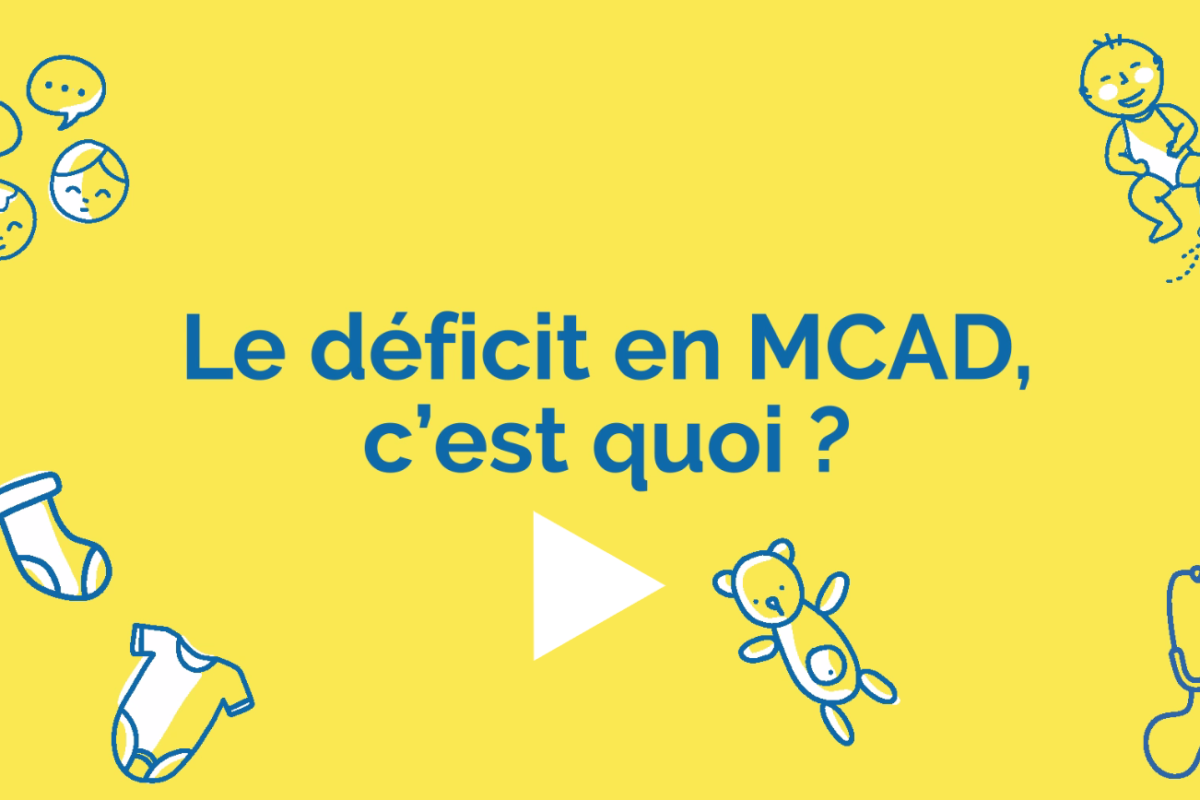Evolution du dépistage néonatal en France : 16 maladies sont recherchées à partir du 1er septembre 2025 (soit 10 de plus en 5 ans) !
Au 1er septembre 2025, l’amyotrophie spinale (SMA), les déficits immunitaires combinés sévères (DICS) et le déficit en VLCAD vont venir compléter le panel des maladies dépistées à la naissance en France.
Qu’est-ce que le dépistage néonatal ?
Il consiste en un prélèvement de quelques gouttes de sang au talon ou à la main du nouveau-né à quelques jours de vie, puis à l’analyse de celui-ci pour rechercher certaines maladies rares. L’objectif est de permettre un diagnostic ultra-précoce, permettant une prise en charge optimale des maladies dépistées.
Quelles sont les nouvelles maladies dépistées ?
L’amyotrophie spinale (SMA) est une maladie génétique entraînant une faiblesse précoce et irréversible des muscles utilisés notamment pour se tenir debout, manger ou même respirer.
Les déficits immunitaires combinés sévères (DICS) altèrent la capacité du corps à se défendre en cas d’agression, ce qui entraîne un risque élevé d’infections graves, voire mortelles.
Le déficit en VLCAD (Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase) est une maladie qui empêche le corps d’utiliser les graisses pour produire de l’énergie. Elle se manifeste surtout en période de jeûne ou lors d’activités physiques.
Le dépistage néonatal, une étape clef pour commencer la vie
En 2023, le dépistage néonatal a permis de dépister 1 276 enfants malades sur le territoire français (en métropole et dans les Départements et Régions d’Outre-Mer), soit une incidence d’un enfant malade pour 530 enfants dépistés.
Au 1er septembre, l’incidence est estimée à 1 enfant malade pour 470 enfants avec une centaine de nouveaux dépistages d’enfants malades dont environ 80 atteints d’amyotrophie spinale.
En 50 ans de dépistage néonatal, ce programme de santé publique a permis de prendre en charge près de 40 000 nouveau-nés malades.
Quels acteurs sont mobilisés pour la prise en charge des nouveaux patients dépistés ?
La prise en charge d’un enfant dépisté dans le cadre du programme national de dépistage néonatal suit un protocole bien défini. Une fois une suspicion biologique identifiée par les Centres Régionaux de Dépistage Néonatal (CRDN), ces derniers orientent rapidement l’enfant vers des professionnels de santé spécialisés dans la pathologie concernée.
La coordination des parcours de soins repose sur les Filières de santé maladies rares (FSMR). Ces structures assurent l’organisation et la mise en réseau des différents acteurs impliqués.
Trois filières sont concernées par les maladies ajoutées à partir du 1er septembre. La filière FILNEMUS est responsable de l’organisation des parcours de soins pour l’amyotrophie spinale (SMA). La filière MaRIH encadre la prise en charge des déficits immunitaires combinés sévères (DICS). Quant à la filière G2M, elle supervise les pathologies métaboliques, incluant le déficit en VLCAD.
Enfin, de nombreuses associations de patients jouent un rôle essentiel en matière de soutien, d’information et d’accompagnement des familles. On peut citer l’AFM-Téléthon, Familles SMA et Ensemble contre l’amyotrophie spinale (ECLAS) pour la SMA, les Feux Follets pour les troubles du métabolisme, l’IRIS pour les déficits immunitaires primitifs, ainsi que l’Alliance Maladies Rares.
Un programme en plein essor
Le dépistage néonatal a débuté en 1972 avec la détection de la phénylcétonurie (1972) puis l’hypothyroïdie congénitale (1978), l’hyperplasie congénitale des surrénales (1995), la drépanocytose (2000) et la mucoviscidose (2002). En 2020, le déficit en MCAD, première erreur innée du métabolisme dépistée, a enrichi le programme. Depuis, le dépistage s’élargit rapidement, avec l’ajout en 2023 de sept nouvelles erreurs innées du métabolisme, et ces trois nouvelles maladies au 1er septembre 2025.
Le panel du dépistage néonatal devrait continuer à s’élargir dans les prochaines années, en accord avec les tendances observées à l’échelle internationale. Les avancées technologiques et les progrès de la recherche, notamment dans le domaine des nouveaux traitements, contribueront à cette évolution.